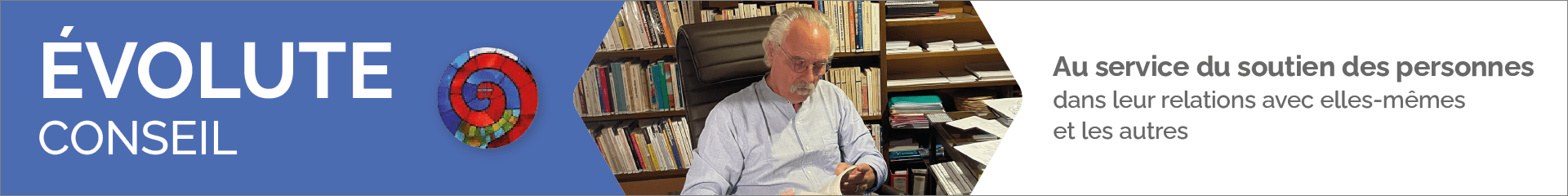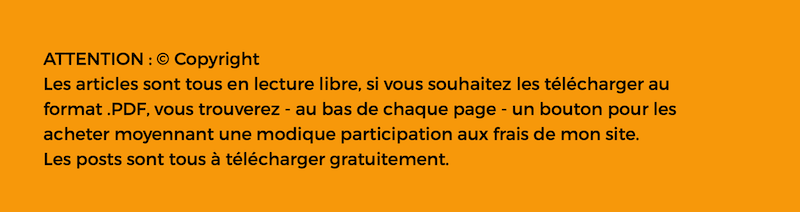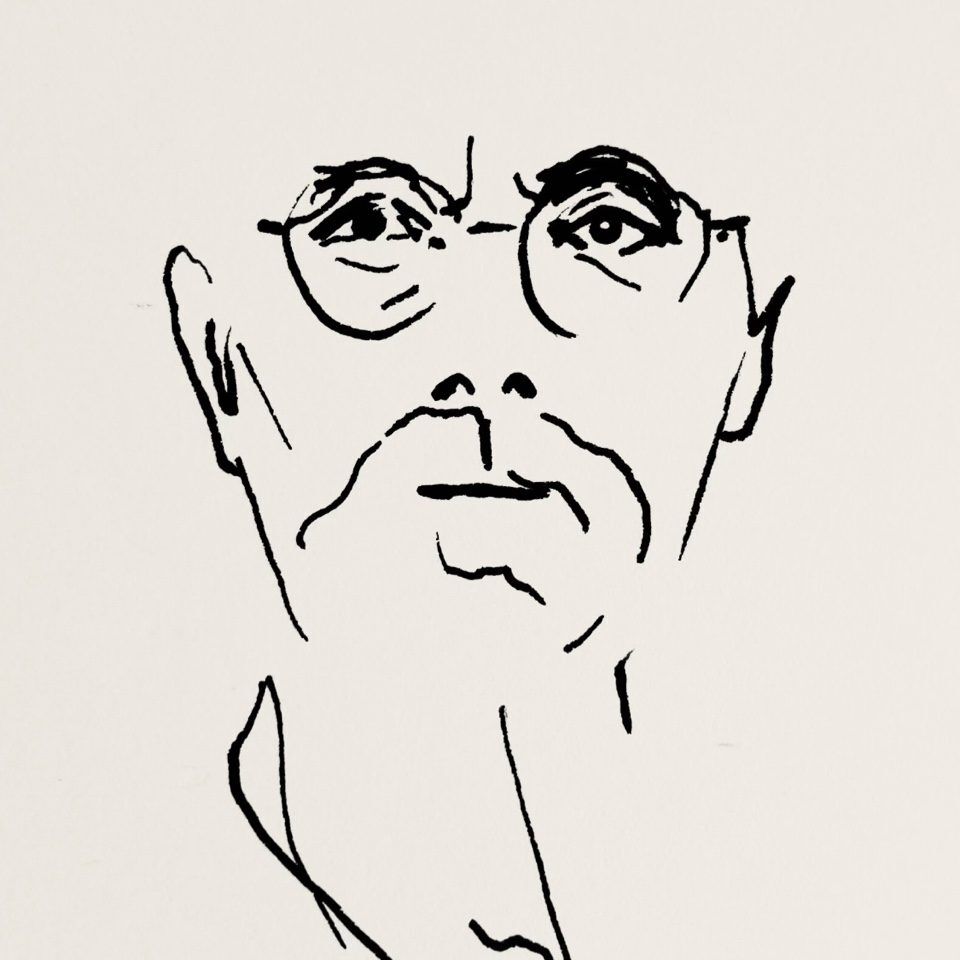« Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre, il suffit juste de dire ce que l’on pense. »
Martin Luther King
« Être vrai, ce n’est pas nécessairement toujours dire toute la vérité, surtout si cela crée de la souffrance, c’est ne pas mentir pour cacher ses erreurs et ses défauts ou, pire, pour tromper autrui par malice. »
Matthieu Ricard
Aujourd’hui, à l’ère des réseaux sociaux, nous sommes sans cesse sollicités à donner notre avis sur tout et n’importe quoi, beaucoup d’entre nous sont convaincus de devoir asséner ce qu’ils pensent à tout un chacun.
Mais peut-on dire, doit-on dire aux autres ce que l’on pense, sous le douteux prétexte de devoir s’affirmer soi-même ?
Notre époque individualiste, égocentrée et narcissique nous incline ainsi à penser que toute censure est illégitime et que l’autocensure est une aliénation.
Persuadés de notre bon droit à exprimer nos opinions, inconscients de l’existence de l’autre en tant qu’il est toujours un autre, nous nous comportons en égocentriques assumés, inattentifs au fait que ce que nous disons sans réfléchir, sans en prendre la pleine mesure, peut blesser les autres.
Or « l’autre est un autre », ce qui signifie que la sensibilité comme l’entendement d’un autre, quel qu’il soit, diffèrent nécessairement des nôtres. « Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà » disait Pascal. Ce qui est vrai et profitable à l’un pourra apparaître faux ou même injuste à un autre, et cela du simple fait que la manière de poser son regard sur les choses de cet autre est différente de la nôtre.
À moins que nous ne voulions nous voir partout, la tolérance élémentaire nous oblige à respecter l’autre comme un autre. Comme le dit le proverbe : « Chacun voit midi à sa porte », alors pourquoi devrions-nous agir comme si nos montres respectives devaient être à la même heure ? Pourquoi une telle attraction pour la pensée unique ?
S’il est des domaines où nous devons avoir le courage de nos convictions, des domaines où laisser dire et laisser faire peut s’apparenter à une lâcheté coupable, il en est de très nombreux parmi lesquels le domaine des relations interpersonnelles (et c’est de celles-ci dont je veux parler) où laisser dire et laisser faire s’apparente à l’hygiène personnelle de celui ou de celle qui a compris que plutôt que de dépenser son énergie à vouloir changer l’autre en le contredisant et en lui assénant une vérité contraire à la sienne, il est préférable de le prendre tel qu’il est en lui laissant la responsabilité de ce qu’il dit ou fait.
Prendre l’autre tel qu’il est, est l’attitude éclairée de celui qui a compris qu’il est nocif d’accomplir des actions inutiles, c’est-à-dire des actions incapables de produire leurs fruits, des actions qui, comme le disait Arnaud Desjardins, sont « immédiatement annulées par une réaction de force égale et opposée. »
Si nous intervenons dans une relation, c’est parce que nous avons confiance dans la capacité de notre intervention à changer les choses. Si – dans une intervention – notre argument permet à l’autre de réagir par un contre argument qui annule notre argument, n’aurions-nous pas mieux fait de ne pas intervenir ? Pour progresser dans un échange, nous avons tous besoin de l’écoute mutuelle qui permet l’appropriation, la maturation et à son terme un possible changement. Si l’échange se limite à se renvoyer la balle mutuellement à partir de forces égales et opposées, l’échange demeurera stérile donc vain. On connaît le proverbe : « Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre », c’est donc une complète perte de temps et d’énergie que de chercher à convaincre quelqu’un qui ne veut pas entendre raison.
Pour exemples les discussions politiques avec les uns et les autres dans lesquelles nous savons pertinemment que les arguments que nous allons utiliser pour nous opposer à l’autre sont ceux-là même qui vont le faire réagir donc l’empêcher de nous écouter. Quand chacun est exclusivement mû par sa réaction à ce que l’autre vient de lui dire, c’est l’ensemble de la relation qui se condamne à un dialogue de sourds.
Et c’est en particulier dans un tel contexte que l’autocensure est précieuse, elle est la « santé » de celui qui, parce qu’il sait que l’autre ne peut qu’être dans la réaction à ses propos, a compris la parfaite inutilité du débat, et décide donc – délibérément – de garder ses arguments pour un autre interlocuteur qui sera – lui – capable de les recevoir.
Qui donc pourrait se prévaloir de pouvoir se faire entendre par « tout le monde » ? L’autocensure s’apparente au libre choix de ne pas dire à l’autre ce que l’on sait qui ne peut pas être entendu par lui. Pour le savoir, convenons qu’il faut l’essayer, mais pourquoi continuer quand on l’a essayé une fois et que ça n’a pas « marché » ?
L’autocensure dont je parle ici ne signifie donc en aucun cas notre soumission à l’autre, puisque loin de nous faire renoncer à nos idées, elle nous permet de garder pour nous ce que nous savons qu’un autre ne peut pas entendre. L’autocensure c’est la simple cohérence avec ce que nous savons inutile.
Sans cette régulation par l’autocensure (autocensure vécue non par soumission à la peur mais par respect consenti à la différence de l’autre), nous ne sommes que pulsions et émotions informes. Et c’est sa propre dignité qui oblige chacun à tenir compte de l’autre dans sa différence.
Si vous vous y entrainez, vous découvrirez que dans une telle perspective, nos relations aux autres nous donnent constamment des opportunités de lâcher prise, en abandonnant les idées fixes que nous entretenons sur nous-même.
Cela s’appelle se libérer du besoin de savoir qui a raison ou qui a tort, et cela permet de voir plus loin les véritables besoins des autres.
Le médecin psychiatre et psychanalyste Edward M. Podvoll, a consacré sa vie à approfondir sa compréhension des mécanismes de l’esprit humain, il pratiquait la méditation bouddhiste et a révolutionné l’accueil et le traitement des personnes psychotiques.
Il résumait l’essentiel de son attitude de base dans sa relation aux autres par la métaphore de la tasse qui illustre très bien l’autocensure dont je parle : « Si quelqu’un me dit « votre tasse de thé est dans mon espace », je déplace tout simplement ma tasse. »
Convenir que l’on ne pourra jamais réussir à faire entendre à l’autre ce qu’il ne peut ou ne veut pas entendre nous permet donc de conclure qu’il est inutile de chercher à « tout dire » à un autre et qu’il est préférable de chercher seulement « ce qu’il peut entendre » en se régulant soi-même par une saine autocensure et que cela nous permettra d’être en paix, à la fois avec nous-mêmes et les autres. Et cela nous permettra aussi d’écouter vraiment les arguments de l’autre, de les recevoir sans les prendre, puisque nous avons décidé de ne pas y répondre. Nous serons « espace d’accueil » et l’autre aura alors peut-être une chance de nous demander : « Et toi tu en penses quoi de tout ça ? » Là, une vraie relation deviendra sans doute possible.
© 2025 Renaud Perronnet. Tous droits réservés.
Illustration :
Marc Haumont, Pensée complexe (2012)
Pour aller plus loin, vous pouvez lire :
- Les autres me déçoivent
- Comment parvenir à ignorer une personne qui nous fait nous sentir mal ?
- Autocensure
Moyennant une modeste participation aux frais de ce site, vous pouvez télécharger l’intégralité de cet article de 4 pages au format PDF, en cliquant sur ce bouton :
Compteur de lectures à la date d’aujourd’hui :
725 vues
ÉVOLUTE Conseil est un cabinet d’accompagnement psychothérapeutique et un site internet interactif de plus de 8 000 partages avec mes réponses.
Avertissement aux lectrices et aux lecteurs :
Ma formation première est celle d’un philosophe. Il est possible que les idées émises dans ces articles vous apparaissent osées ou déconcertantes. Le travail de connaissance de soi devant passer par votre propre expérience, je ne vous invite pas à croire ces idées parce qu’elles sont écrites, mais à vérifier par vous-même si ce qui est écrit (et que peut-être vous découvrez) est vrai ou non pour vous, afin de vous permettre d’en tirer vos propres conclusions (et peut-être de vous en servir pour mettre en doute certaines de vos anciennes certitudes.)